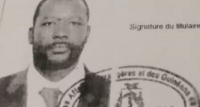Le tribunal correctionnel d’Abidjan a reconnu ce jeudi 2 décembre 2021 l’homme d’affaires congolo-malien, Oumar Diawara coupable des faits de ‘’complicité d’abus de biens sociaux et blanchiments de capitaux’’, au terme d’un procès qui s’est déroulé en l’absence du prévenu.
En effet, Oumar Diawara était poursuivi devant les juridictions nationales pour des faits de complicité d’abus de biens sociaux et de blanchiment de capitaux portant sur la somme de 15 milliards de francs CFA.
Cette procédure est consécutive à une plainte de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) de Côte d’Ivoire, suite à une transaction réalisée en fraude des intérêts de l’Etat de Côte d’Ivoire, à travers la BNI, société d’Etat, et BNI GESTION, société à participation publique majoritaire, avait expliqué le porte-parole parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly; précisant que le prévenu ne s’était jamais présenté devant le juge « se prévalant d’une qualité, celle de diplomate, qu’il n’a pas » .
Ainsi, le tribunal a lourdement condamné Oumar Diawara entre autres à 20 ans de prison ferme, 50 milliards FCFA d’amende, 25 milliards FCFA de dommages et intérêts à payer à l’Etat de Côte d’Ivoire, la confiscation de ses biens, l’interdiction de séjour sur le territoire ivoirien.
Un mandat d’arrêt a, également, été lancé contre lui.
Le 22 novembre 2021, un incident est survenu à l’aéroport de Bamako (Mali) , avec la tentative de saisie d’un aéronef de la compagnie AIR Côte d’Ivoire par Oumar Diawara , sur le fondement d’une décision de la Cour de Justice de la CEDEAO condamnant l’Etat de Côte d’ivoire à lui payer la somme d’un milliard deux cent cinquante millions de francs CFA en réparation de la violation de ses droits.
Une décision de la Cour de Justice de la CEDEAO que le gouvernement ivoirien estime avoir été « prise en violation de ses droits » et entend user de toutes les voies de droit pour la contester. Source / Rk/ Abidjan.net News
À Lire aussi
L’homme d’affaire Oumar Diawara sera jugé le 25 novembre prochain pour des faits de complicité d’abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux, apprend KOACI de sources proches du dossier.
Il ressort de nos investigations qu'en 2018, sans la vigilance de l‘agent judiciaire du Trésor, il coulerait des jours tranquilles en Côte d’Ivoire. Avec la complicité de cadres de la BNI, dont deux sont poursuivis, Oumar Diawara, Malien né au Congo et de nationalité malienne, congolaise et guinéenne avait failli réaliser un grand coup, gagner frauduleusement 15 milliards d’actifs (terrains, ndlr) de l’Etat au prix d’un investissement d’1,05 milliard. Les faits
Le 10 Aout 2018, Madame l’Agent judiciaire du Trésor, avait saisi le Doyen des Juges d’Instruction d’une plainte avec constitution de partie civile contre le sieur Diawara Oumar, gérant de la Société Ivoirienne des Dépôts (SIDD) pour des faits de complicité d’abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux.
Au soutien de sa plainte, l’Agent Judiciaire du Trésor avait expliqué que la BNI-Gestion, est une société à participation financière publique majoritaire (65 % de son capital social) ayant pour objet la gestion d’Organisme de Placement Commun en valeur Mobilière (OPCVM) et dirigée à l’époque des faits de la cause par Madame Fatoumata Konaré.
Conformément à son objet, la BNI-Gestion avait mis sur le marché deux produits dénommés FCP Capital Croissance et FCP Dynamic Savings auxquels avait souscrit largement le public. Dans le cadre de son fonctionnement, cette entité financière, avec les fonds en provenance de ces Fonds Communs de Placement (FCP), avait acquis dans le courant de l’année 2016, par différents actes notariés de multiples terrains non bâtis dans les communes d’Assinie, Cocody et Bingerville pour un montant de treize milliards quatre cent cinquante-huit millions quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-neuf (13.458.095.589) de francs CFA. Poursuivant, nous apprenons que la plaignante avait indiqué que suite à ces différentes acquisitions faites par cette structure financière, le Conseil Régional de l’Epargne Publique (CREPMF), l’autorité de régulation du marché financier de la zone UEMOA, avait fait injonction à la BNI Gestion d’avoir à cesser toute opération immobilière car n’étant pas autorisée à gérer des actifs immobiliers conformément à la règlementation bancaire en vigueur.
Pour se conformer à cette injonction du régulateur, la BNI Gestion avait alors choisi de céder tous ses terrains non bâtis à la somme de quinze milliards (15.000.000.000) de francs CFA à la société PERL INVEST SASU.
La plaignante avait précisé que la BNI Gestion était l’associée unique et détenait 100% du capital social de PERL INVEST SASU et les dirigeants étaient les mêmes que ceux de BNI Gestion.
Elle avait ajouté que pour pallier ce déficit causé aux deux Fonds Communs de Placement (FCP), la société PERL INVEST SASU avait sollicité et obtenu un prêt de quinze milliards (15.000.000.000) de francs CFA auprès de la BGFI Bank CI, avec comme garantie le compte principal de la BNI Gestion et les deux sous comptes des Fonds Communs de Placement (FCP), signée par Madame le Directeur Général de la BNI Gestion, sans autorisation préalable du Conseil d’Administration.
L’Autorité de régulation le CREPMF avait elle, dénoncé cette cession, motifs pris de ce que la BNI Gestion étant l’associé unique de la société PERL INVEST SASU, exerçait indirectement la gestion non autorisée d’actif et l’a sommé d’y mette fin. Pour se conformer à cette nouvelle injonction, le 18 Juillet 2017, la BNI Gestion avait cédé la totalité des actions et des actifs immobiliers de PERL INVEST SASU à la Société Ivoirienne de Dépôt de Douane SIDD, société à responsabilité unipersonnelle, avec pour gérant le Nommé Diawara Oumar, à la somme d’un milliard cinquante-neuf millions (1.059.000.000) de francs CFA.
Il ressort de notre enquête, que l’Agent Judiciaire du Trésor avait révélé que sans informer le conseil d’administration, Madame Fatoumata Konaré en même temps qu’elle signait l’acte de cession de la société PERL INVEST avec le transfert de ses passifs et actifs, a procédé également à la signature au profit de la BGFI Bank CI, d’une autorisation de remboursement permettant à celle-ci de se faire rembourser la dette de 15 milliards (15.000.000.000) de francs CFA de la société PERL INVEST par le débit des comptes de Fonds Communs de Placement de la BNI Gestion.
L’Agent Judiciaire du Trésor avait précisé que suite à la cession de PERL INVEST SASU à la SIDD, la BGFI Bank CI a débité effectivement les comptes donnés en garantie de la somme de quatorze milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions trente-trois mille cinq cent cinquante-et-un (14.485.033.551) francs CFA pour se rembourser le prêt consenti à PERL INVEST SASU.
L’Agent Judiciaire du Trésor avait soutenu par ailleurs, que selon ses investigations, les fonds des FCP n’avaient pas été utilisées entièrement à l’achat des terrains comme convenu. Enfin, l’Agent Judiciaire du Trésor a déclaré que Madame Konaré épouse Sakandé Cissé, parmi les deux cadres de la BNI poursuivis, ayant cédé PERL INVEST au prix d’un milliard cinquante-neuf millions (1.059.000.000) de francs CFA alors qu’elle savait que PERL INVEST SASU avait un patrimoine immobilier acquis à quinze milliards (15.000.000.000) de francs CFA, a abusé des biens de la société BNI Gestion.
Selon la plaignante, ce montage financier et ces différentes cessions immobilières ont été effectuées en fraude des intérêts de BNI Gestion. Une information judiciaire était ouverte à l’encontre de Diawara Oumar et autres pour les faits de présomptions graves de complicité d’abus de biens sociaux et de blanchiment de capitaux.
Plusieurs fois convoqué, il avait refusé de comparaitre sous couvert d’être un diplomate avant de s’enfuir. Après investigations, les enquêteurs découvriront qu’à défaut de son épouse, Oumar Diawara n’a jamais été diplomate. Il s'est toujours présenté comme commerçant ou directeur de société, comme en attestent plusieurs documents consultés lors de notre enquête.=
Oumar Diawara jouira néanmoins de l'aide de la représentante de l'Union Africaine en Côte d'Ivoire, la congolaise Joséphine-Charlotte Mayuma Kala, qui n'hésitera pas à s'ingérer dans ce dossier, comme l'attestent des documents consultés. Enfin, à titre conservatoire, le magistrat instructeur prenait le 05 décembre 2018, une ordonnance portant interdiction de toutes transactions immobilières sur les parcelles litigieuses à la requête de l’État de Côte d’Ivoire, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT).
Une bien sale affaire qui sera donc jugée jeudi à Abidjan. Source Amy Touré KOACI.COM
À Lire aussi
Affaire Oumar Diawara VS BNI Gestion: la Côte d’Ivoire fait fi de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO
L’homme d’affaire congolo-malien Oumar Diawara a remporté, le 22 octobre dernier, une bataille judiciaire inédite contre l’Etat de Côte d’Ivoire dans l’affaire qui l’oppose à la BNI Gestion. La plus haute instance judiciaire de la zone CEDEAO lui a donné raison. La cour basée à Abuja condamne la Côte d’Ivoire à payer les dommages et intérêts fixés à un milliard deux cent cinquante millions de Franc CFA (1 250 millions FCFA) en sus d’une restitution des terres dont la valeur est fixée à vingt milliards de francs Cfa.
Genèse d’un imbroglio: quand BNI Gestion a cédé Perl Invest Pour comprendre l’affaire, un bref retour en arrière est nécessaire. En dates du 12 décembre 2016 et du 6 Juin 2017, le régulateur du marché financier (CREPMF) de l’UEMOA a adressé des injonctions à BNI Gestion l’invitant à céder l’ensemble de son actif immobilier détenu par le biais de sa filiale Perl Invest au motif que cela ne répondait pas à l’agrément de gestion qui lui a été accordé.
En exécution de ces injonctions, le Conseil d’Administration de BNI Gestion a décidé de céder ladite filiale. C’est dans ce cadre que la société SIDD dont Oumar Diawara est le patron s’est portée acquéreur de Perl Invest par acte de cession en date du 18 Juillet 2017. Selon le rapport du cabinet d’expertise comptable Excelsior, au moment de sa cession, la société Perl Invest détenait un patrimoine immobilier estimé à 16 milliards de Francs Cfa et une dette de 15 milliards de Francs Cfa dans les livres de BGFI Bank Abidjan.
En conformité avec le rapport de ce cabinet d’expertise comptable, l’homme d’affaire Oumar Diawara a à cet effet procédé à l’opération de l’acquisition de la société Perl Invest en déboursant la somme de 2 472 535 103 de Francs Cfa repartie comme suit : 1 059 000 000 (un milliard cinquante-neuf millions de francs CFA) payés cash; 1 413 535 103 FCFA (un milliard quatre cent treize millions cinq cent trente-cinq mille cent trois francs CFA) par compensation des fonds payés à BNI Gestion par les souscripteurs des programmes immobiliers.
A la suite de cette acquisition, Oumar Diawara a adressé deux courriers à la BGFI Bank pour discuter des modalités de remboursement de la dette de la société Perl Invest dans ses livres. Malheureusement, les deux courriers sont restés sans suite. Ce n’est qu’à postériori que l’homme d’affaire a été informé par BNI Gestion que Madame Sakandé Cissé Fatoumata, son ex Directrice Générale, licenciée pour abus de biens sociaux et contre qui une plainte au pénal a été portée, avait, le jour même de la cession de Perl Invest, donné autorisation écrite à BGFI Bank pour se faire rembourser sa créance détenue sur Perl Invest par l’utilisation des avoirs de BNI Gestion domiciliés dans ses livres.
Par ailleurs, BNI Gestion a saisi le Tribunal de Commerce pour voir BGFI Bank être condamnée à rétrocéder ses avoirs utilisés pour le remboursement de la dette de Perl Invest.
C’est ainsi que le 28 décembre 2017, par un courrier, Oumar Diawara saisit la BNI Gestion pour proposer de lui rétrocéder les terres qui ne faisaient pas l’objet d’investissement et de faire le point sur la balance des dettes. Cette énième tentative est restée infructueuse.
Après avoir épuisé toutes les voies administratives, l’homme d’affaire congolo-malien a décidé de déposer une plainte avec constitution de partie civile contre BNI Gestion et Madame Sakande Cissé Fatoumata (Directrice générale de la BNI) pour escroquerie, car la superficie réelle des terres du patrimoine immobilier de Perl Invest était largement en deçà de la superficie indiquée lors de l’acquisition.
Envoyée au Gnouf, la DG de BNI Gestion libérée contre caution. Puis grosse surprise Les différentes plaintes de Oumar Diawara ont eu pour conséquence l’emprisonnement de la directrice générale de la BNI Gestion pour une durée de trois semaines avant que des interventions de tierces personnes ne permettent son élargissement contre paiement d’une caution de 100 millions de FCFA et la levée de son interdiction de sortie du territoire pour une affaire dont le préjudice est estimé à 8 milliards FCFA. C’est dans ce contexte pour le moins rocambolesque que le juge du 9 éme cabinet d’instruction auprès de qui l’affaire avait été confiée a commandité une expertise immobilière qui a conduit à la production d’un rapport de constat sans équivoque sur la superficie réelle des terres. Mais, au plus grand étonnement des conseils de l’homme d’affaire Oumar Diawara, le dossier pénal suivi contre Madame Sakandé Cissé Fatoumata (Directrice de la BNI ) a disparu du 9 éme Cabinet pour se retrouver au 5ème Cabinet sans que les avocats de Monsieur Oumar Diawara ne soient informés.
Selon les informations, l’actuel ministre des finances de la Côte d’ivoire, Adama Coulibaly, qui fut administrateur à la BNI, n’a menagé aucun effort pour bloquer cette affaire pendante devant la justice. Parallèlement à la procédure engagée par Oumar Diawara, une plainte contre l’argentier a été déposée courant août 2018 par l’Agent Judiciaire du Trésor, la nommée Kadiatou Ly avec constitution de partie civile, pour complicité d’abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux. Puis c’est la surprise.
Comment en une nuit, passer du statut privé au public Par un mystère connu d’elle seule, Madame Kadiatou Ly a tenté d’attribuer à Perl Invest un statut de société à participation financière publique.
C’est dans cette confusion et sans même auditionner une des parties, en l’occurrence Monsieur Oumar Diawara, que la juge du 5ème Cabinet d’instruction a procédé à la saisie des terrains appartenant à Perl Invest, le 17 décembre 2018, en violation de toutes les procédures, estime le conseil de l’homme d’affaires. Lequel a fait appel de l’ensemble des ordonnances émises par le juge d’instruction du cabinet.
19 mois d’obstruction plus tard Durant plus de 19 mois en appel, la juge d’instruction du 5 ème cabinet en charge de l’affaire a manifestement fait obstruction de transmettre le dossier au second degré afin que les juges d’appel puissent statuer. C’est face à cet état de faits que le conseil de l’homme d’affaire Oumar Diawara a fini par saisir la Cour de Cassation pour demander le dessaisissement du juge du 5 ème Cabinet en la personne de Madame Blanche Abanet Esso. Suite à la requête du conseil de l’homme d’affaire Oumar Diawara, la Cour de Cassation a donné droit à cette requête par décision rendue le 27 Octobre 2020. Dans l’intervalle, le 20 Octobre 2020, BNI Gestion a définitivement remporté son procès contre BGFI Bank qui s’est vue condamner à lui rembourser les fonds (FCFA 14,4 milliards ) indument utilisés pour l’apurement de la dette de Perl Invest. Ainsi, après le dessaisissement du juge du 5ème Cabinet par la cour de cassation, Madame blanche Abanet Esso aurait, selon nos sources, usé de son influence auprès du Ministre de la justice Sassan Kambilé qui aurait exercé une pression sur les juges de la Cour de Cassation afin que cette haute institution puisse par conséquent annuler sa décision de dessaisissement du juge du 5eme cabinet.
La médiation avortée du ministre des Finances de l’époque Face à la tournure des événements, le Ministère de l’Économie et des Finances de l’époque, Adama Koné, avait proposé sa médiation et un accord avait même été trouvé avant que BNI Gestion ne fasse volte-face et ne refuse de signer le protocole d’accord validé par toutes les parties. Ainsi cette tentative de règlement à l’amiable initiée par le ministre des Finances a échoué, laissant la place à un acharnement judiciaire contre l’homme d’affaire Oumar Diawara à travers l’Agent Judiciaire du Trésor en charge de la défense des intérêts de l’Etat, en complicité avec la juge d’instruction du 5ème Cabinet, Mme Abanet Esso Blanche. Cette magistrate avait pourtant été dessaisie du dossier par la Cour de Cassation qui l’avait sanctionnée et réaffectée du fait des nombreuses irrégularités dont elle s’était rendue coupable dans l’instruction de l’affaire. Mais en dépit de cette sanction, elle avait été néanmoins autorisée par la Présidente de cette même instance de cassation à garder son dossier.
Le recours à la justice communautaire Au terme de quatre années de batailles judiciaires et après avoir épuisé toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires, l’homme d’affaire Oumar Diawara s’ est finalement résolu à saisir la cour de justice de la communauté qui a tranché, le 22 octobre 2021 dernier.
Les juges indépendants de cette juridiction ont annulé tous les actes judiciaires délivrés par la justice de l’Etat de Côte d’Ivoire contre l’opérateur économique congolo-malien. L’affaire Oumar Diawara vs BNI Gestion s’est donc soldée par la condamnation de l’Etat ivoirien par la Cour de justice de la CEDEAO, au paiement de la somme de « un milliard deux cent cinquante millions (1. 250. 000.000) de francs CFA en réparation de la violation des droits du requérant », plus un franc symbolique pour le préjudice moral. ==== Les fausses déclarations à l’actif et au passif de Perl Invest, faites sur des surfaces fictives, des biens immobiliers et le détournement de plusieurs milliards dont se sont rendus coupables les administrateurs de la Banque Nationale Ivoirienne, à travers leur filiale BNI Gestion, ont été mises à nu par la justice communautaire. L’affaire fait ressortir nettement l’implication de hauts responsables de l’Etat ivoirien, en l’occurrence l’Agent Judiciaire du Trésor et les magistrats, dont la Présidente de la Cour de Cassation ainsi que la magistrate en charge du dossier au 5ème cabinet qui aux dernières nouvelles a été nommée au 11 éme cabinet.
La BNI Gestion est une entreprise privée que les magistrats ivoiriens, en violation du traité de l’OHADA, ont voulu faire passer pour une entreprise publique sans le moindre début de preuve. L’arrêt de la Cour de la CEDEAO met en évidence le spectaculaire revirement de la présidente de la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire, qui avait pris un arrêt contre la juge du 5ème cabinet avec «pour conséquence de lui retirer tous ses pouvoirs sur les affaires de la 5ème chambre d’où elle a été transférée et de les confier au nouveau juge qui lui succède». Néanmoins, la juge en question a gardé le dossier par devers elle et continué à instruire l’affaire.
Pour la Cour de la CEDEAO, le fait qu’elle ait continué à retenir le dossier après l’ordre de transfert jetait un doute légitime sur sa partialité.
La Cour de la CEDEAO estime donc que les actes de la juge de la 5ème chambre, Madame Blanche Ananet Esso , constituent des atteintes graves au droit de l’homme d’affaires Oumar Diawara à un procès équitable. Le constat des juges de la cour de justice de la CEDEAO est clair : «sur la base des faits qui lui sont présentés, la Cour constate que la procédure conduisant à l’extinction des droits du requérant sur le bien est illégale, car elle n’est pas conforme à la loi et qu’elle a violé le droit à un procès équitable… ».
La Cour de Justice de la CEDEAO conclut donc que «l a violation du principe du procès équitable, dans le cadre d’un tribunal, d’une procédure ou d’une décision rend les décisions qui peuvent en découler nulles et non avenues et sans effet».
Dans leur épilogue, les juges de la CEDEAO arguent que l’opérateur économique Oumar Diawara avait fourni des preuves irréfutables de ses droits de propriété sur Perl Invest et qu’il avait donc légalement acquis la société.
Dernière minute …
Au moment où nous mettions sous presse, une information de dernière minute fait état du renvoi du dossier suscité en jugement pénal mais l’audience, fixée initialement le 11 novembre, a été renvoyée au 25 novembre, le conseil de monsieur Diawara évoquant le fait qu’il ne pouvait pas assister à une audience pour laquelle il n’avait pas été informé. Pour les avocats de l’homme d’affaire, c’est une guerre de clochers qui commence après le revers d’Abuja. Les avocats comptent désormais lancer les procédures de saisies du patrimoine de la Côte d’Ivoire à l’étranger au cas où le pays refuserait d’exécuter la décision rendue par la cour de justice de la CEDEAO dont il est membre.
Source https://www.financialafrik.com Par Rodrigue Fenelon Massala, grand reporter.
Plus de 355 000 délégués du NDC étaient attendus dans 401 centres de vote à travers le pays pour le scrutin de samedi. Un temps en lice, l’ancien gouverneur de la banque centrale Kwabena Duffuor s’était retiré de la course vendredi soir, affirmant que le parti n’était pas prêt à conduire « une élection libre et juste ».







 Mali : 5 coups d'Etat depuis l’indépendance L'ex-Soudan français, actuel Mali, a enregistré 5 coups d’État depuis son indépendance de la colonisation française, le 22 septembre 1960.
Mali : 5 coups d'Etat depuis l’indépendance L'ex-Soudan français, actuel Mali, a enregistré 5 coups d’État depuis son indépendance de la colonisation française, le 22 septembre 1960.
 À lire aussi :Idriss Dagnogo · PUTSCHS À RÉPÉTITIONS AU MALI / À QUAND LA PRISE DE CONSCIENCE ?
À lire aussi :Idriss Dagnogo · PUTSCHS À RÉPÉTITIONS AU MALI / À QUAND LA PRISE DE CONSCIENCE ?
 Les Maliens vivants en République du Mali et pro putschistes pensent que le monde se limite qu'à Bamako et environs par conséquent ils peuvent se permettre de tout sans aucune retenue.
Les Maliens vivants en République du Mali et pro putschistes pensent que le monde se limite qu'à Bamako et environs par conséquent ils peuvent se permettre de tout sans aucune retenue. 
 Hier, lors de la fameuse marche contre la Ecowas - Cedeao nous avons eu l'impression que c'était à la vérité une marche contre la Côte d’Ivoire par ricochet contre son excellence Alassane Ouattara. Les Maliens pro putschistes ont finit par nous montrer hier qu'à la vérité ils nourrissent un dédain inouïe et exécrable contre leur voisin d'à côté.
Hier, lors de la fameuse marche contre la Ecowas - Cedeao nous avons eu l'impression que c'était à la vérité une marche contre la Côte d’Ivoire par ricochet contre son excellence Alassane Ouattara. Les Maliens pro putschistes ont finit par nous montrer hier qu'à la vérité ils nourrissent un dédain inouïe et exécrable contre leur voisin d'à côté. Grand fut notre émoi mais pas étonnant d'entendre l'un des bouffons de la tribune populiste des nouveaux panafricons maliens, de chialer ceci en bambara " que les terroristes attaquent Abidjan et fassent de la CI une base ..." et voir une foule en liesse face à de tels propos. Mais cette foule ignorante oublie que c'est parceque c'est ADO qui est là sinon si c'était leur soutien panafricon GBAGBO LAURENT ,les jeunes patriotes de Blé Goude Charles officiel envahiraient les commerces Maliens et les attaquer dans les différentes communes de Abidjan . Mais, tellement que Ouattara a su bien éduqué son peuple et sa jeunesse en particulier, on continue de garder notre harmonie fraternelle avec les ressortissants maliens résidents chez nous .
Grand fut notre émoi mais pas étonnant d'entendre l'un des bouffons de la tribune populiste des nouveaux panafricons maliens, de chialer ceci en bambara " que les terroristes attaquent Abidjan et fassent de la CI une base ..." et voir une foule en liesse face à de tels propos. Mais cette foule ignorante oublie que c'est parceque c'est ADO qui est là sinon si c'était leur soutien panafricon GBAGBO LAURENT ,les jeunes patriotes de Blé Goude Charles officiel envahiraient les commerces Maliens et les attaquer dans les différentes communes de Abidjan . Mais, tellement que Ouattara a su bien éduqué son peuple et sa jeunesse en particulier, on continue de garder notre harmonie fraternelle avec les ressortissants maliens résidents chez nous . Allah an-dêmin 🙏🙏🙏 Par Moustapha Ben BobI
Allah an-dêmin 🙏🙏🙏 Par Moustapha Ben BobI
 Ce sont les analyses d'experts politiques improvisés ou patentés des réseaux sociaux, à la suite de la batterie de sanctions infligée à l'Etat du Mali par la CEDEAO lors du sommet des chefs d'Etats tenu à Accra.
Ce sont les analyses d'experts politiques improvisés ou patentés des réseaux sociaux, à la suite de la batterie de sanctions infligée à l'Etat du Mali par la CEDEAO lors du sommet des chefs d'Etats tenu à Accra. Un peu de réalisme dans les propositions. Force au Mali et à son peuple.
Un peu de réalisme dans les propositions. Force au Mali et à son peuple. 

 « Certains Africains sont encore complices »
« Certains Africains sont encore complices » 
 Oumar Mariko restera en prison jusqu’à son procès. Le président du parti Sadi était retenu depuis hier matin dans les locaux de la gendarmerie. En garde-à-vue pendant près de 48 heures, il a finalement été placé sous mandat de dépôt ce mardi après-midi 7 décembre. Ainsi que deux autres personnes accusées avec lui d’avoir tenu et diffusé des propos qualifiés d’injurieux contre le Premier ministre Choguel Maïga. Les trois hommes ont été transférés en début d’après-midi à la Maison centrale d’arrêt de Bamako.
Oumar Mariko restera en prison jusqu’à son procès. Le président du parti Sadi était retenu depuis hier matin dans les locaux de la gendarmerie. En garde-à-vue pendant près de 48 heures, il a finalement été placé sous mandat de dépôt ce mardi après-midi 7 décembre. Ainsi que deux autres personnes accusées avec lui d’avoir tenu et diffusé des propos qualifiés d’injurieux contre le Premier ministre Choguel Maïga. Les trois hommes ont été transférés en début d’après-midi à la Maison centrale d’arrêt de Bamako.