L’OIC a pour mission de renforcer le secteur mondial du Café et d’encourager son développement durable dans le cadre d’une économie de marché pour le bien-être de tous les acteurs de la chaîne de valeur de cette spéculation.
Les pays membres représentent 98% de la production et plus de 67% de la consommation mondiale de café.
Les travaux qui se tenaient à Bangalore ont enregistré la participation de 80 pays et 2600 délégués
En effet, pour rendre le travail du l’OIC plus efficace, l’Accord international de 2022 sur le café (AIC) établit deux comités : le Comité des finances et de l’administration (CFA) et le Comité économique (CE). Le CFA continuera d’examiner les questions financières et administratives de l’OIC dans la continuité de l’AIC 2007. Le CE, quant à lui, intégrera tous les objectifs et activités techniques et stratégiques des trois comités techniques existant dans le cadre de l’AIC 2007 (statistiques ; promotion et développement des marchés ; et projets), y compris ceux qui étaient liés au Forum consultatif sur le financement du secteur du café et qui sont maintenant traités par le Groupe de travail public-privé sur le café (GTPPC).
IMali : L'Éviction de Choguel Maïga et les Défis d'une Transition Instable**
Dans un contexte de tensions croissantes entre civils et militaires, l'éviction de Choguel Maïga, Premier ministre du Mali, par la junte dirigée par Assimi Goïta, crée des incertitudes majeures pour la stabilité politique et la sécurité du pays. Ce tournant, qui soulève de nombreuses questions sur la gouvernance et les perspectives économiques, met en lumière les risques d'une radicalisation croissante au sein de la population malienne, rendant urgente la nécessité d'un dialogue inclusif et constructif pour garantir un avenir serein.
L'éviction de Choguel Maïga, Premier ministre du Mali, par Assimi Goïta soulève plusieurs enjeux et conséquences significatifs sur la situation politique, sociale et sécuritaire du pays. Voici une analyse critique de cette situation :
### 1. **Instabilité Politique Accrue**
- **Tensions entre civils et militaires :** Le limogeage de Maïga, qui a exprimé des critiques envers la junte, met en lumière les tensions croissantes entre les acteurs civils et militaires au Mali. Cela pourrait engendrer une polarisation plus profonde, rendant la diplomatie et le consensus plus difficiles.
- **Perception de la gouvernance :** Cette décision pourrait nuire à la réputation du gouvernement militaire, perçu comme instable et incapable de maintenir un environnement politique serein. Les citoyens pourraient devenir plus méfiants vis-à-vis des promesses de transition vers un retour à un régime civil.
### 2. **Impact sur la Sécurité**
- **Concentrations de pouvoir:** Le renvoi de Maïga pourrait également signifier un renforcement du contrôle militaire sur les affaires gouvernementales, ce qui pourrait aggraver les tensions internes. Dans un contexte d’insécurité exacerbée par des groupes djihadistes, une gouvernance instable pourrait nuire à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité globale du pays.
- **Détérioration des relations internationales :** Le limogeage pourrait également influencer la posture internationale du Mali, surtout vis-à-vis de ses partenaires traditionnels, qui sont préoccupés par la dérive autoritaire. Cela pourrait limiter l'assistance ou la coopération internationale, cruciale pour faire face aux défis sécuritaires.
### 3. **Conséquences Économiques**
- **Incertitude économique :** L'instabilité politique peut décourager les investissements nationaux et étrangers, alors que le Mali cherche désespérément à relancer son économie et à stimuler le développement. Un climat d'incertitude impacte directement la confiance des acteurs économiques.
- **Impact sur les aides internationales :** Les partenaires internationaux pourraient réévaluer leur aide en fonction des développements politiques, affectant des secteurs déjà fragiles tels que l'éducation, la santé et les infrastructures.
### 4. **Réactions Sociopolitiques**
- **Mobilisation des citoyens :** L’éviction pourrait provoquer des réactions de diverses factions politiques, de la société civile et d'autres groupes intéressés. Cela pourrait entraîner des manifestations, augmentant encore la tension et la polarisation dans le pays.
- **Radicalisation potentielle :** Une gestion inappropriée de cette transition pourrait alimenter le ressentiment et la radicalisation au sein de la population, surtout les jeunes, ce qui pourrait favoriser l'adhésion aux groupes extrémistes.
### Conclusion
L'éviction de Choguel Maïga représente un tournant potentiellement dangereux dans le paysage politique malien. Les conséquences sur la stabilité politique, la sécurité, l'économie et le tissu social doivent être suivies attentivement. Le pays a besoin d'un dialogue inclusif et constructif pour naviguer à travers cette crise et trouver un chemin vers une gouvernance stable et efficace qui répond aux besoins de la population malienne. La communauté internationale, quant à elle, doit surveiller ces développements de près pour apporter un soutien adapté au peuple malien dans sa quête de paix et de stabilité.
L'analyse de la trahison présumée de Choguel Maïga envers ses collègues et partenaires politiques depuis le début de la transition militaire au Mali soulève plusieurs points d'intérêt qui méritent d'être examinés. Voici une réflexion critique sur cette situation et ses implications :
### 1. **Dynamique de la Transition et Relations Politico-Militaires**
- **Contexte Politique :** Depuis le coup d'État de 2020, le Mali a connu une transition complexe impliquant un mélange d’autoritarisme militaire et de promesses de retour à la démocratie. Choguel Maïga, en tant que Premier ministre, a eu un rôle prépondérant dans la conduite de cette transition, mais aussi dans la gestion des relations avec d'autres acteurs politiques, notamment ceux du G5 Sahel.
- **Érosion de la confiance :** Si Maïga est perçu comme ayant trahi ses partenaires du G5, cela pourrait créer une fracture au sein même de l’entourage politique qui aurait tenté de trouver un terrain d’entente avec la junte militaire. Une telle trahison serait susceptible d'éroder la confiance entre les fonctionnaires et d'alimenter le ressentiment parmi ceux qui se sont mobilisés pour aider à encadrer la transition.
### 2. **Impact sur l'Unité Politique du G5**
- **Fragmentation des Alliances :** La trahison pourrait avoir des répercussions sur l’unité et la cohésion des partis au sein du G5, un groupe déjà confronté à divers défis en matière de solidarité face à la transition militaire. Les dissensions internes pourraient affaiblir la position du G5 face à la junte.
- **Risques de Fragmentation :** Si certains membres du G5 estiment que Maïga a abandonné les préceptes de coopération et de solidarité, cela pourrait inciter à une dissociation des alliés, où chacun chercherait à protéger ses propres intérêts au lieu de fonctionner comme une entité unifiée.
### 3. **Conséquences sur la Légitimité et les Perspectives de Transition**
- **Légitimité Ébranlée :** La trahison perçue pourrait affecter la légitimité de Maïga et, par extension, celle de la junte elle-même. Ces événements pourraient être interprétés comme un signe d'instabilité et d'impréparation du gouvernement intérimaire à tenir ses promesses de démocratie.
- **Défis pour le Futur :** La suspicion et l’hostilité croissantes pourraient compliquer les futures négociations politiques sur la transition et pourraient empêcher une coopération substantielle envers le retour à un gouvernement civil stable.
### 4. **Répercussions Sociales et Mobilisation Populaire**
- **Réactions des Partis et des Électeurs :** Les trahisons politiques peuvent générer une désillusion parmi les électeurs et les membres des partis qui s'étaient initialement alignés sur Maïga. Cela pourrait fomenter un climat de méfiance envers les dirigeants et entraîner une mobilization de la société civile contre des figures qui, comme Maïga, sont perçues comme étant corrompues par le pouvoir.
- **Polarisation Sociale :** Un climat de trahison pourrait exacerber la polarisation sociale en incitant les partisans de différents camps à prendre position plus fermement, en conséquence de discours politiques incendiaires.
### Conclusion
La trahison de Choguel Maïga envers ses collègues du G5 pourrait être interprétée comme un épisode révélateur dans la tumultueuse transition politique du Mali. Les conséquences de cette trahison pourraient non seulement fragiliser les alliances politiques existantes, mais aussi entraver la légitimité du gouvernement intérimaire. La nécessité d'un dialogue et d'une réconciliation sincère parmi les différents acteurs politiques devient cruciale pour construire une transition stable et éviter des divisions qui pourraient nuire à l'ensemble du pays. Ce contexte souligne l’importance de la transparence et de la confiance comme fondements d’une gouvernance effective et participative.









 Il est décrit comme l’architecte du projet Pastef. Son choix qui a surpris beaucoup d’analystes et d’observateurs de la scène politique, est pourtant évident et logique selon Ousmane Sonko lui-même. « Mon choix sur Diomaye n’est pas un choix de cœur mais de raison. Je l’ai choisi parce qu’il remplit les critères que j’ai définis. Il est compétent et a fait la plus prestigieuse école du Sénégal. Après presque 20 ans aux Impôts et Domaines où il a abattu un travail exceptionnel, personne ne peut dire qu’il n’est pas intègre. Je dirais même qu’il est plus intègre que moi. Je place le projet entre ses mains « , a déclaré Ousmane Sonko à son sujeElection présidentielle au Sénégal: Qui est Bassirou Diomaye Faye, le probable prochain président du Sénégal ?
Il est décrit comme l’architecte du projet Pastef. Son choix qui a surpris beaucoup d’analystes et d’observateurs de la scène politique, est pourtant évident et logique selon Ousmane Sonko lui-même. « Mon choix sur Diomaye n’est pas un choix de cœur mais de raison. Je l’ai choisi parce qu’il remplit les critères que j’ai définis. Il est compétent et a fait la plus prestigieuse école du Sénégal. Après presque 20 ans aux Impôts et Domaines où il a abattu un travail exceptionnel, personne ne peut dire qu’il n’est pas intègre. Je dirais même qu’il est plus intègre que moi. Je place le projet entre ses mains « , a déclaré Ousmane Sonko à son sujeElection présidentielle au Sénégal: Qui est Bassirou Diomaye Faye, le probable prochain président du Sénégal ? 
 «L’or va servir à la couverture, c’est faux de dire qu’on n’a l’or, que l’État malien a de l’or’’, a déclaré l’ancien ministre Konimba SIDIBÉ, tout en précisant que l’or appartenait aux sociétés qui l’exploitent.
«L’or va servir à la couverture, c’est faux de dire qu’on n’a l’or, que l’État malien a de l’or’’, a déclaré l’ancien ministre Konimba SIDIBÉ, tout en précisant que l’or appartenait aux sociétés qui l’exploitent. Abordant la question de la monnaie, le Chef de l’Etat du Niger avait déclaré que cela était un signe de souveraineté.
Abordant la question de la monnaie, le Chef de l’Etat du Niger avait déclaré que cela était un signe de souveraineté.
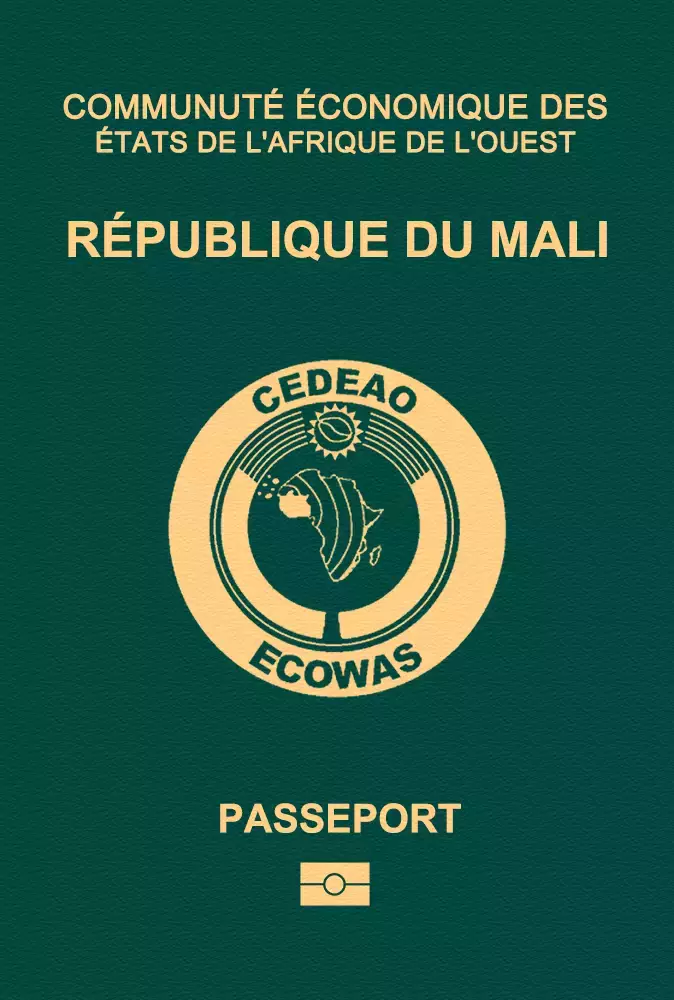

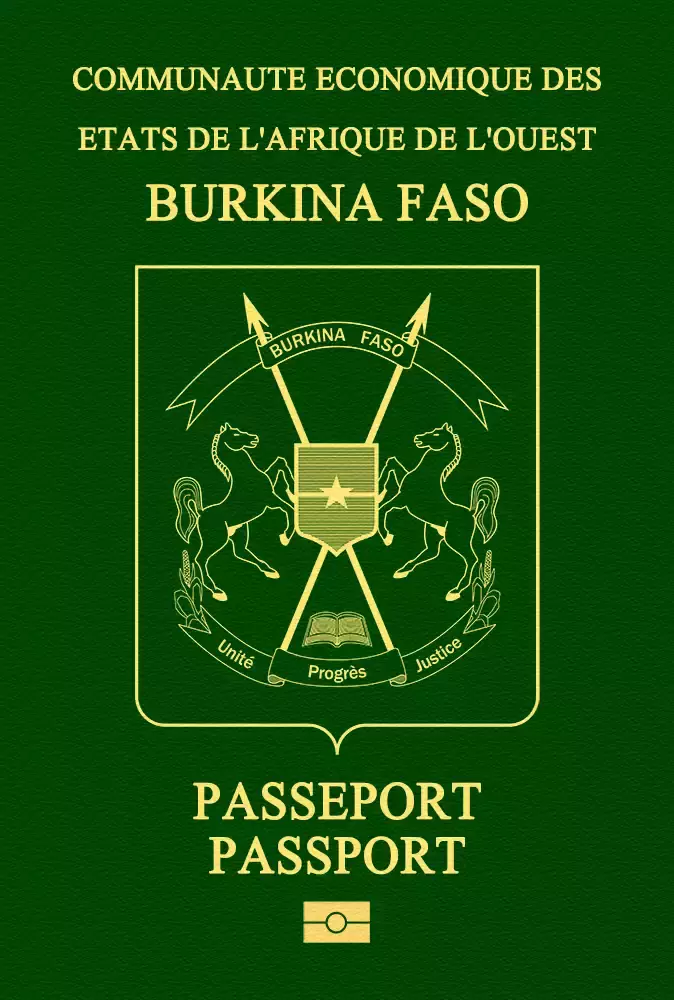 Les dirigeants respectifs des trois États sahéliens, "prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leurs populations, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États d'Afrique de l'ouest", dit le communiqué lu sur les médias d'État de ces pays.
Les dirigeants respectifs des trois États sahéliens, "prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leurs populations, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États d'Afrique de l'ouest", dit le communiqué lu sur les médias d'État de ces pays. 
